Par Christine Lambert – Whisky magazine – Mars 2025
La mesure des phénols responsables des arômes tourbés fait apparaître des chiffres qui chutent dramatiquement selon qu’elle est réalisée sur le malt… ou sur le whisky. Mais alors, où disparaissent-ils entre-temps?
Parlons magie et tours de passe-passe si vous le voulez bien. Mais au lieu d’escamoter les colombes dans un haut de forme, étudions comment les phénols disparaissent d’un whisky tourbé. Molécules aromatiques responsables des notes fumées/médicinales, ces phénols sont mesurés en parties par million, autrement dit en ppm, l’acronyme préféré des peat geeks (faites le test!). Le storytelling des distillerie nous encourage à croire que plus le nombre de ppm est élevé plus le whisky sera tourbé: l’effet waouh du phénol, dont Octomore a poussé le curseur au max.
Le hic? Les ppm sont mesurées sur le malt. Logique, puisque les phénols se fixent sur l’orge lors du maltage, au moment du kilning (séchage au four): la fumée phénolique dégagée par la pyrolyse de la tourbe dépose ces molécules sur l’enveloppe de la céréale, le husk. Pour faciliter les échanges commerciaux, il n’est pas complètement idiot que les malteurs aient pris l’habitude de ppm-iser (oui, j’invente des mots, à rebours de l’époque qui les supprime) le grain. Il est plus discutable que l’industrie du whisky ait perpétué cette convention.
À la drèche, les phénols!
Car à l’arrivée, dans votre verre, 50 à 80% des ppm se seront esbignés, dans des variations très notables selon l’équipement et les procédés de fabrication. Les rarissimes marques et distilleries qui, dans un soucis de transparence, ont pris l’habitude de communiquer les ppm analysés sur le liquide – AnCnoc, Ailsa Bay, Torabhaig, Meikle Tòir… – donnent un aperçu de la grande évasion. Prenez la cuvée Cnoc Na Moine de Torabhaig: 78,4 ppm sur l’orge (waouh) mais… 19,7 ppm dans le whisky (oups). Tandis que le Peathart d’AnCnoc affiche 34 ppm sur l’orge et 13,3 ppm dans la quille.
Alors « la » question à 12.000 ppm: où sont passés les phénols? En fait, ils s’évanouissent à chaque étape ou presque de la fabrication. Au broyage, d’abord, puisque l’enveloppe de l’orge où ils se fixent se dissémine en partie à la sortie du moulin. Lors du brassage ensuite, à des degrés divers selon que le moût est plus ou moins filtré. La plupart du temps, le husk tamise le moût au fond du mashtun… et les phénols partent dans la drèche.
A la fermentation, ça se complique. Bien que le débat ne soit pas tranché dans la recherche, d’autres phénols semblent se créer pendant cette étape, sans que l’on sache s’ils participent au profil tourbé du whisky.
De la fumée sous les queues
Mais c’est la distillation qui fait le grand ménage dans les ppm. « Ces molécules lourdes ne veulent pas être distillées! », insiste Barry Harrison, chercheur au Scotch Whisky Research Institute. De fait, leur point d’ébullition est beaucoup plus élevé que l’éthanol, les esters ou l’eau. Le guaiacol et les crésols, par exemple, familles de phénols apportant respectivement des notes cendrées, camphrées et des arômes médicinaux se dispersent aux environ de 200° C, détaille-t-il dans l’indispensable ouvrage de Mike Billett, Peat and Whisky, the Unbreakable Bond.
Les composés les plus lourds s’envoient donc en l’air dans l’alambic vers la fin de la distillation, et notamment dans les queues: par conséquent, les coupes sont souvent ajustées à la baisse quand on distille du whisky tourbé.
Une distillation lente, en provoquant davantage de reflux (et de contact avec le cuivre purificateur du pot still), dégommera davantage de ppm. Le volume de queues (plus tourbées, donc – merci de suivre ou de faire semblant) réinjecté dans la seconde distillation influence également le résultat.
Parlons de l’arrière-train des molécules
Evidemment, la forme, la taille, la charge de l’alambic, la présence ou non d’un purificateur et l’inclinaison du col, en minimisant ou maximisant le reflux jouent un rôle déterminant. Ce qui explique que Caol Ila, qui utilise le même malt à 35 ppm que Lagavulin, offre un ressenti moins tourbé que sa frangine de Kildalton.
Inutile de préciser que dans un alambic peu chargé, très haut et armé d’un col ascendant, les phénols vont avoir bien du mal à hisser leur petit popotin fumé, et retomberont dans le pot still tant qu’ils ne se seront pas allégés.
Mais, là encore, mieux vaut ne pas raisonner en termes de quantités de phénols: certains types de congénères ont un impact démesuré à des taux de détection très bas. Un peu comme le sel ou le poivre dans la cuisine: ajoutez-en 2 cuillérées à café dans votre assiette de purée et vous ne sentirez plus les patates!
Reste le vieillissement, sans doute l’étape qui offre le plus matière à questionnement. Quiconque a goûté des whiskies tourbés très âgés sait que les phénols disparaissent avec le temps. Mais ce n’est pas aussi simple.


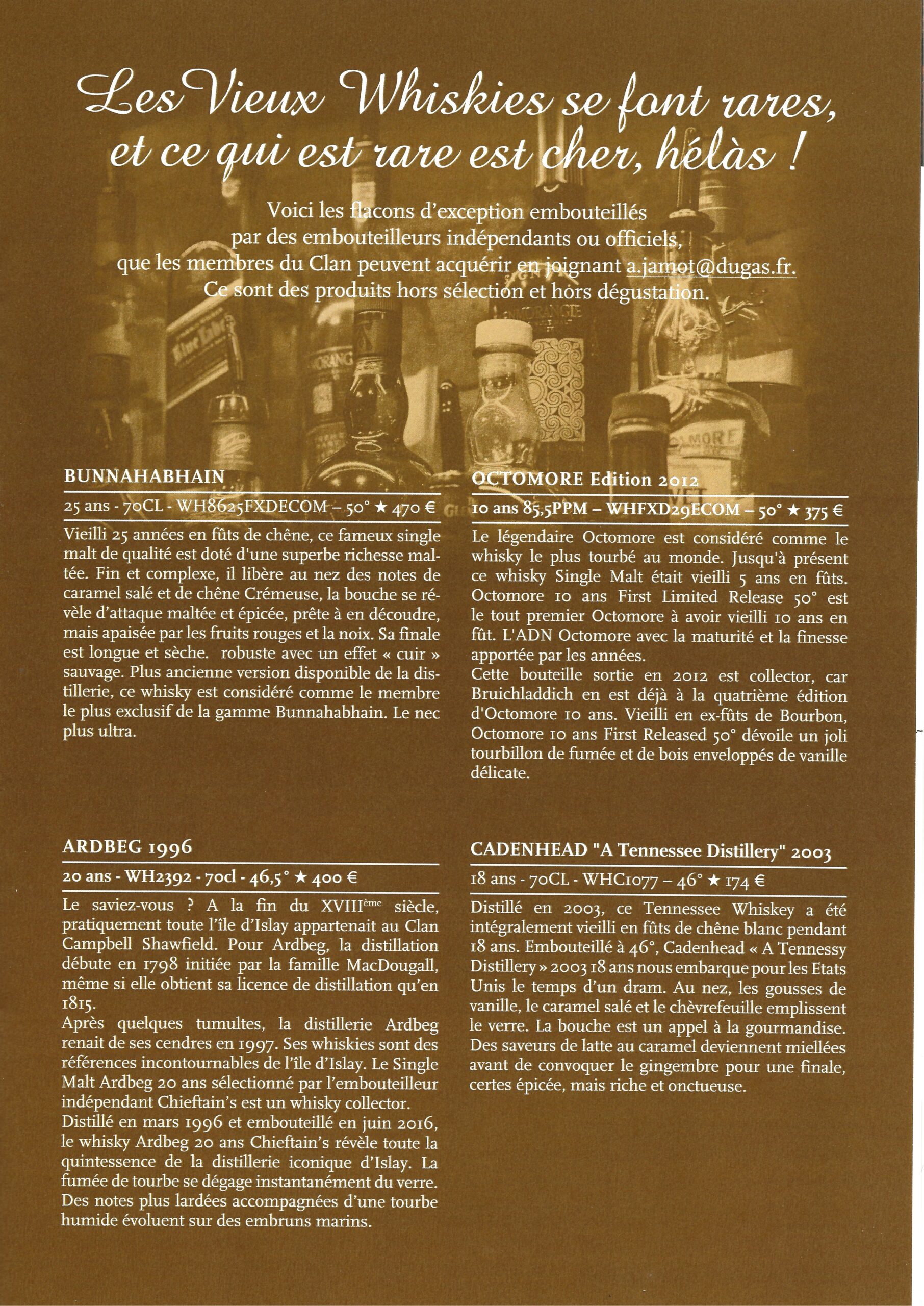
 Après de nombreuses fois remises, nous voici .. à Nancy où la choucroute n’est pas ce que l’on croyait, même dans un magnifique décor art nouveau !
Après de nombreuses fois remises, nous voici .. à Nancy où la choucroute n’est pas ce que l’on croyait, même dans un magnifique décor art nouveau ! A seulement 39 ans, Michaël Barbaria incarne la nouvelle génération d’embouteilleurs indépendants. Du cognac au whisky en passant par le calvados, l’armagnac et le rhum, Michaël Barbaria rend hommage à chacune des catégories et aux histoires familiales qui se cachent derrière chaque cuvée qu’il sélectionne et embouteille.
A seulement 39 ans, Michaël Barbaria incarne la nouvelle génération d’embouteilleurs indépendants. Du cognac au whisky en passant par le calvados, l’armagnac et le rhum, Michaël Barbaria rend hommage à chacune des catégories et aux histoires familiales qui se cachent derrière chaque cuvée qu’il sélectionne et embouteille.
