Par Jean-Pierre Saccani – Publié le 22 avril 2025 – Le Figaro
La distillerie finlandaise Kyrö innove avec une édition limitée qui a été vieillie en fût de rhum jamaïcain avant de transpirer dans une étuve chauffée à 55 degrés. Coup marketing ou coup de génie ?
Où va-t-on s’arrêter en termes de finish ? Chantre des whiskies de seigle, la distillerie finlandaise Kyrö (prononcer kireu) repousse les limites en utilisant une technique totalement inédite : la finition en sauna. Une démarche qui coule de source pour le maître distillateur Kalle Valkonen. Il rappelle en effet que l’idée de la marque est née en 2012, alors que ses cinq futurs fondateurs prenaient ensemble un bain de vapeur en dégustant un rye whisky. Comme cette catégorie n’existait pas en Finlande, ils ont décidé de lancer le leur. Treize ans plus tard, voilà leur première édition limitée (1 908 flacons à 139 c). D’abord élevé en barrique de chêne américain
neuf, Kyrö Sauna Stories N°1 (50,8 %) est passé ensuite dans un fût de rhum jamaïcain Planteray qui a fini par suer à grosses gouttes dans l’étuve. De quoi ravir la planète geek, toujours friande de telles démarches mais les autres ?«Les dirigeants de Kyrö ont une vraie vision et ils travaillent avec des équipements de qualité», souligne Alexandre Gabriel, propriétaire de Planteray. Toujours en recherche de finish originaux, il échange des fûts avec la
distillerie finlandaise. «Mettre le fût dans un sauna ouvre les pores de bois et entraîne une interaction énorme avec le liquide. En résultent des notes exotiques de mangue, d’ananas séché, de banane très mûre. C’est une expression qui a germé dans l’esprit d’une équipe un peu folle mais très talentueuse», résume Alexandre Gabriel.
Vieilles traditions nordiques
Comme la plupart des distilleries nordiques, Kyrö utilise des matières premières locales, du seigle complet en l’occurrence et élabore du whisky de manière artisanale en privilégiant les fermentations longues et les distillations lentes dans de petits alambics. Produisant du gin, de la vodka et quatre whiskies dans sa gamme permanente, la distillerie d’Isokyrö remet aussi au goût du jour de vieilles traditions nordiques comme celle de fumer son malt à l’aulne (un arbre qui pousse en zones humides) ou avec de la tourbe d’eau douce. Un traitement réservé aux cuvées Wood Smoke et Peat Smoke.
Kyrö Sauna Stories N°1 aura-t-elle une suite ? Oui, à en croire Nicolas Cauchois qui dirige Distill Spirit, le distributeur de Kyrö en France, le deuxième marché à l’export de la distillerie finlandaise. «Mais cette édition n’aura pas un profil rhum comme la précédente.», précise-t-il sans en dévoiler plus. En revanche, il est plus disert sur l’étape du sauna. «Les fûts y sont restés huit heures à une température de 55 degrés. C’est court mais le sauna est un accélérateur qui permet d’obtenir un vieillissement tropical dans un pays froid.» De fait, la Finlande connaît un climat proche de celui de l’Écosse…
Un nuage vient en revanche d’assombrir l’avenir prometteur de Kyrö. La distillerie finlandaise pourra-t-elle conserver l’étiquette rye whisky qui est l’un de ses marqueurs ? Rien n’est moins sûr depuis le 1 er avril. Un traité signé en 2003 entre l’Union européenne et le Canada laissant l’usage exclusif de cette appellation à ce dernier est soudainement ressorti des oubliettes. Et ce n’est pas un poisson d’avril contrairement à ce qu’ont d’abord pensé les dirigeants de Kyrö. «OutRYEgeous» ont-ils réagi sur Linkedin pour dire combien cette mesure était scandaleuse (=
outrageous). Une réponse originale, à l’image de leurs whiskies à découvrir quelle que soit l’issue de cette affaire.



 Alors que de plus en plus de brasseurs utilisent des fûts de whisky pour la finition de leurs bières, voilà un single malt qui a séjourné dans un fût… ayant contenu de l’India Pale Ale. C’est Glenfiddich, leader du secteur, qui s’est lancé dans l’aventure.
Alors que de plus en plus de brasseurs utilisent des fûts de whisky pour la finition de leurs bières, voilà un single malt qui a séjourné dans un fût… ayant contenu de l’India Pale Ale. C’est Glenfiddich, leader du secteur, qui s’est lancé dans l’aventure.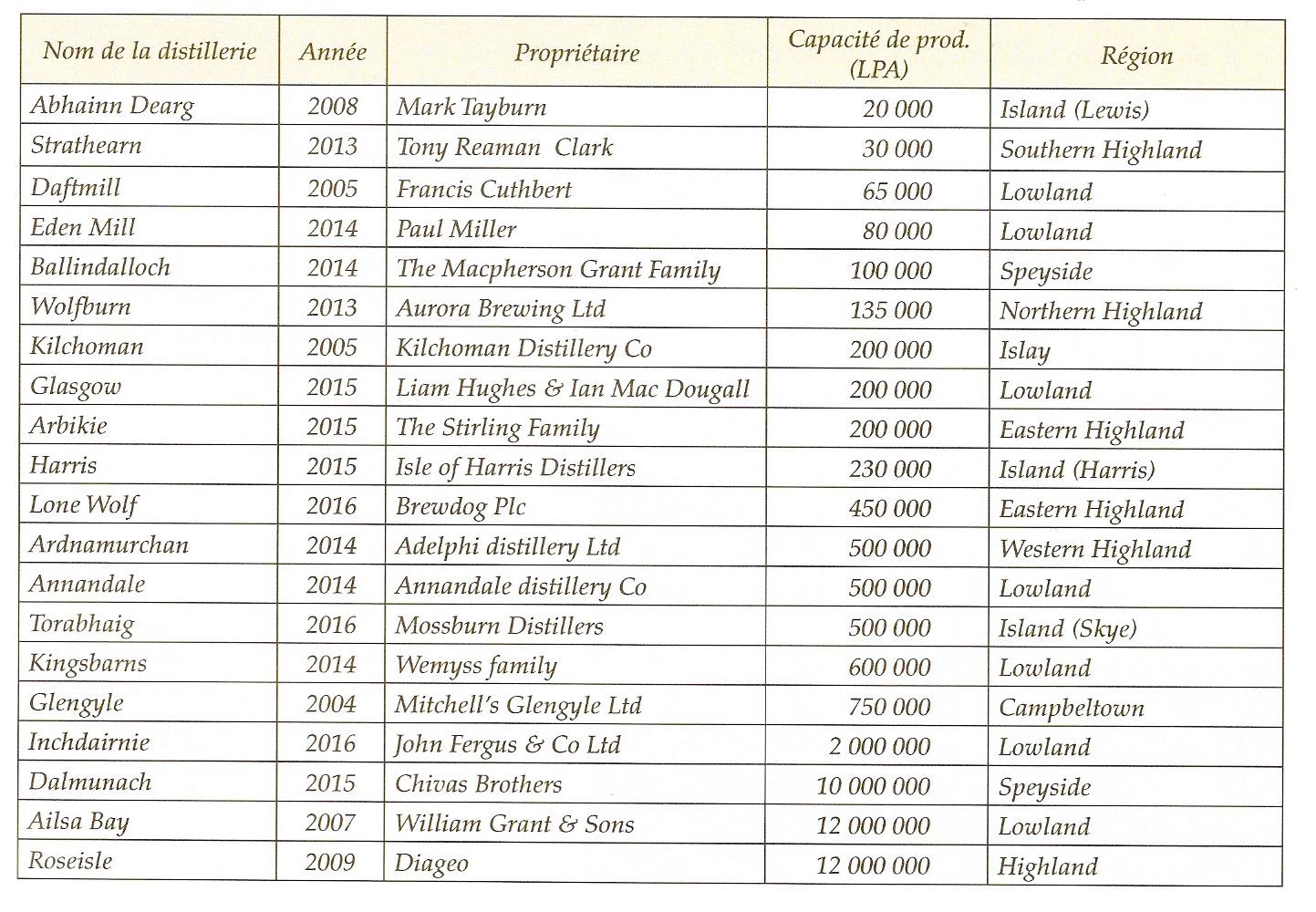
 malt «traditionnel», à partir d’une orge maltée sur une aire de maltage, d’effectuer une
malt «traditionnel», à partir d’une orge maltée sur une aire de maltage, d’effectuer une

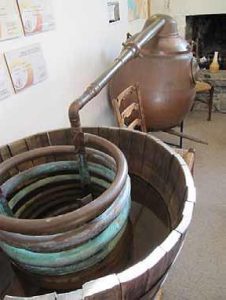

 Suite et fin Par Tony TERRAIN
Suite et fin Par Tony TERRAIN



